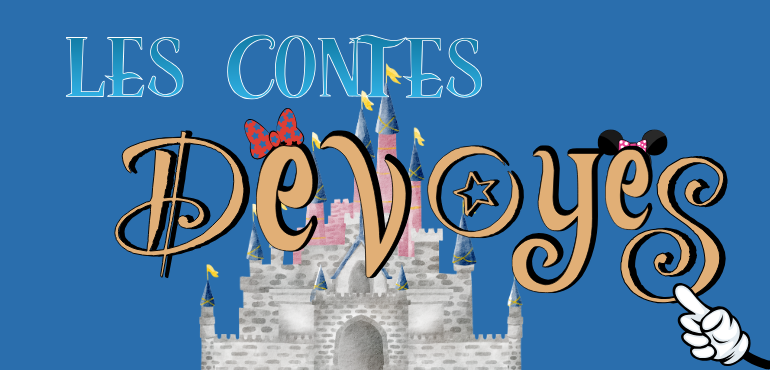Les contes dévoyés : l'exemple Disney
1. Édulcoration des contenus
Les contes traditionnels sont souvent sombres, violents, ambigus, car ils reflètent les réalités de la vie (mort, abandon, inceste, pauvreté, peur de l’autre, transgression...).
cf La peur dans les contes ou la transmission orale pour adultes
→ Disney supprime ou adoucit ces éléments pour les rendre acceptables, entendables par un public familial :
- Dans Cendrillon, les demi-sœurs ne se mutilent plus les pieds (comme chez les frères Grimm).
- Dans La Petite Sirène, l’héroïne ne meurt pas de chagrin : elle épouse le prince au lieu de se dissoudre dans l’écume.
Conséquence : le conte ne prépare plus à affronter les épreuves, il fait rêver à une vie idéalisée, sans réel danger.
2. Mise en avant de l’amour romantique
Alors que les contes d’origine parlent souvent de stratégie, de survie, de transmission générationnelle, Disney les transforme en histoires d’amour hétérosexuel idéalisé :
- Le but de l’héroïne devient : être belle, douce, obéissante… pour être aimée et épouser un prince.
Ce modèle renforce les stéréotypes de genre :
- La femme attend, l’homme sauve.
- La beauté est récompensée, l’intelligence ou l’audace souvent punies.
3. Uniformisation culturelle et esthétique
Les versions Disney imposent une iconographie dominante (robes, châteaux, princesses blanches aux cheveux longs) au détriment de la richesse des traditions orales du monde entier :
- L'univers est toujours féérique, propre, pastel, coupé de la terre, du réel et du mystère.
- Les contes du monde sont standardisés selon une grille occidentale, souvent dépolitisés et désexualisés.
4. Commercialisation massive
Le conte devient un produit de consommation, associé à une gamme de jouets, de costumes, de parcs d’attraction.
→ Ce système entretient une vision de l’histoire comme marchandise, divertissement et nostalgie, et non comme outil de pensée critique ou de résistance.
5. Mais des réappropriations critiques existent !
Heureusement, depuis les années 1990-2000, de nombreux artistes, auteurs, pédagogues et conteurs détournent ou réinterprètent les contes classiques pour :
- Réintroduire le doute, la nuance, le symbolique.
- Dénoncer les stéréotypes de genre ou les inégalités.
- Retrouver la puissance subversive, féministe ou politique des récits originels.
Exemples :
- Contes à l’envers (Pef),
- Il était une fois une vieille femme très méchante (François David),
- Princesses oubliées ou inconnues (Philippe Lechermeier),
- Les contes racontés par les conteurs contemporains dans des festivals adultes.