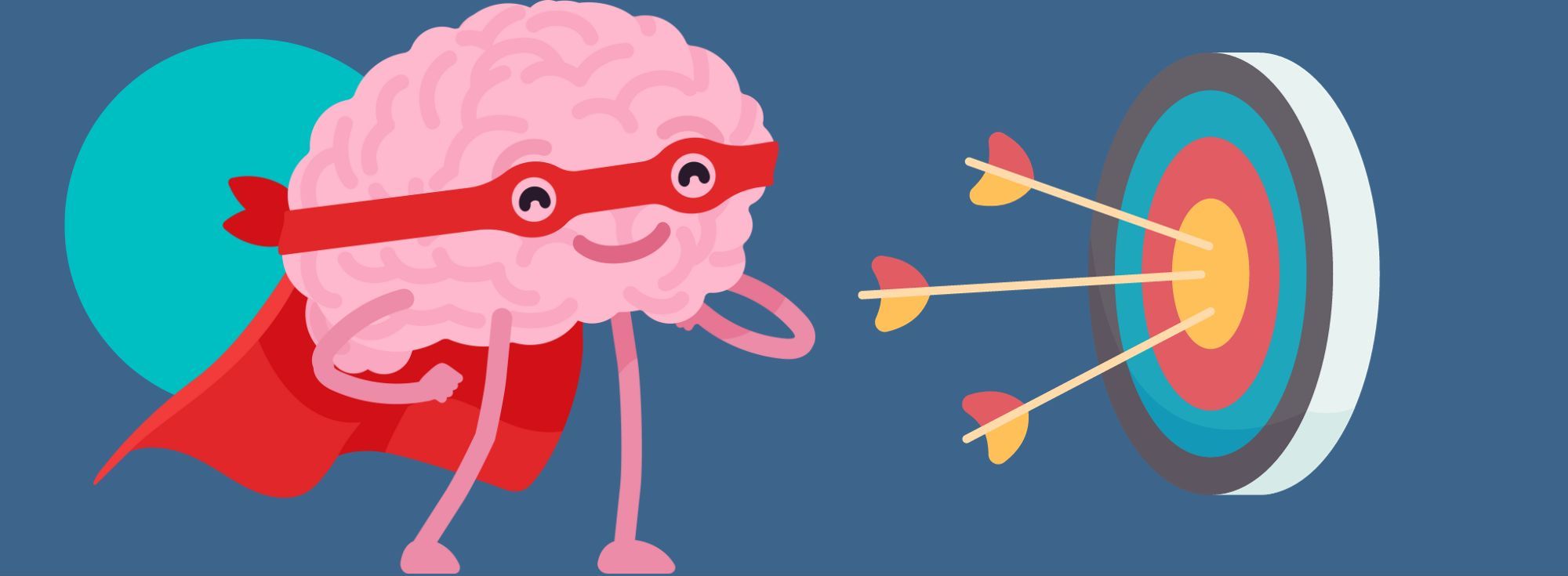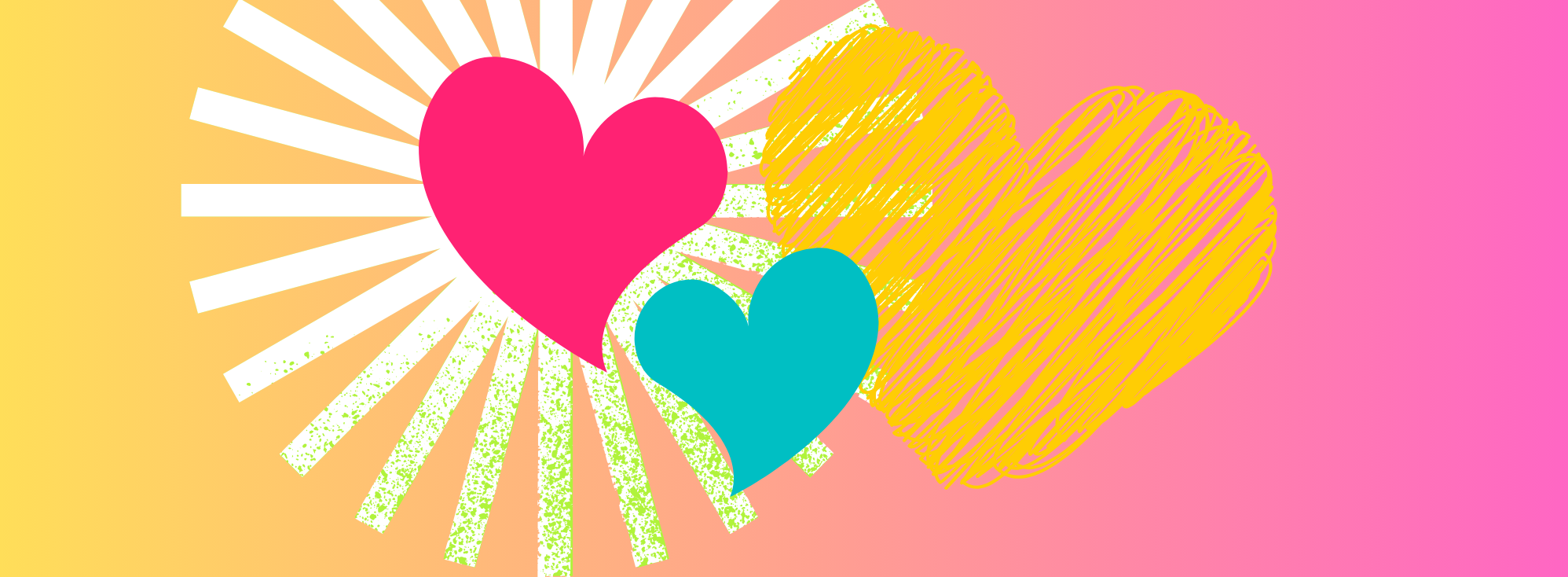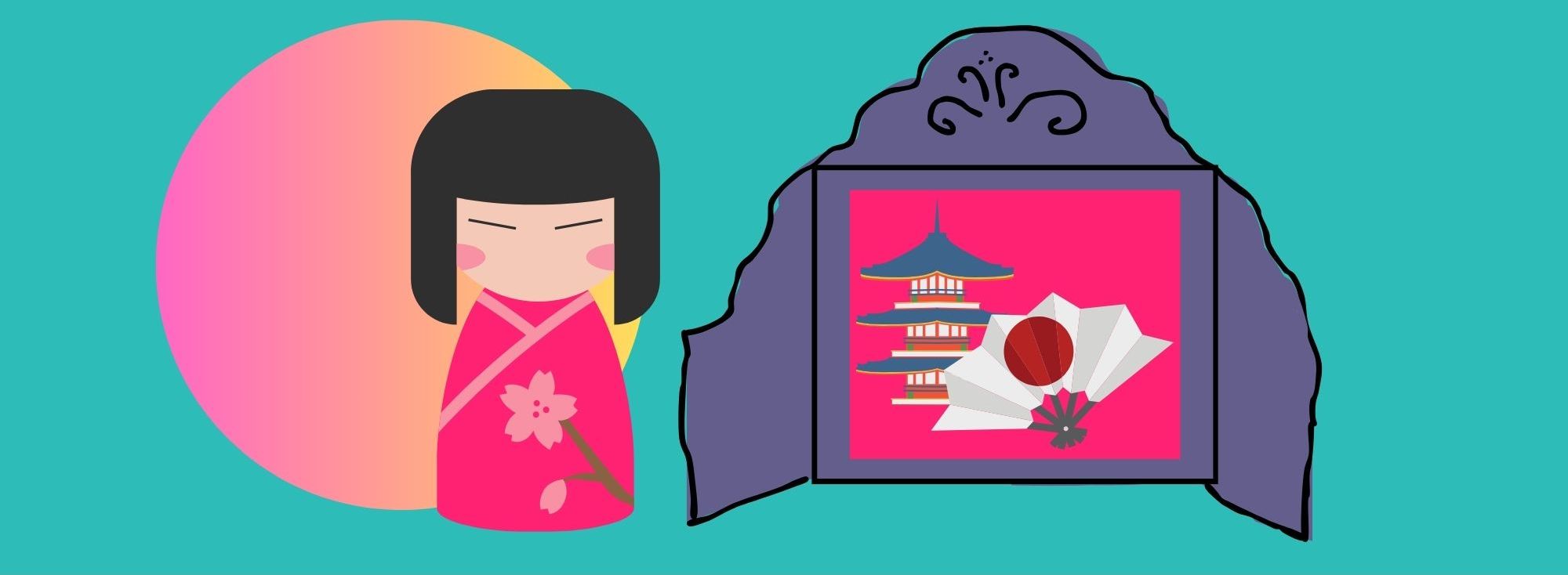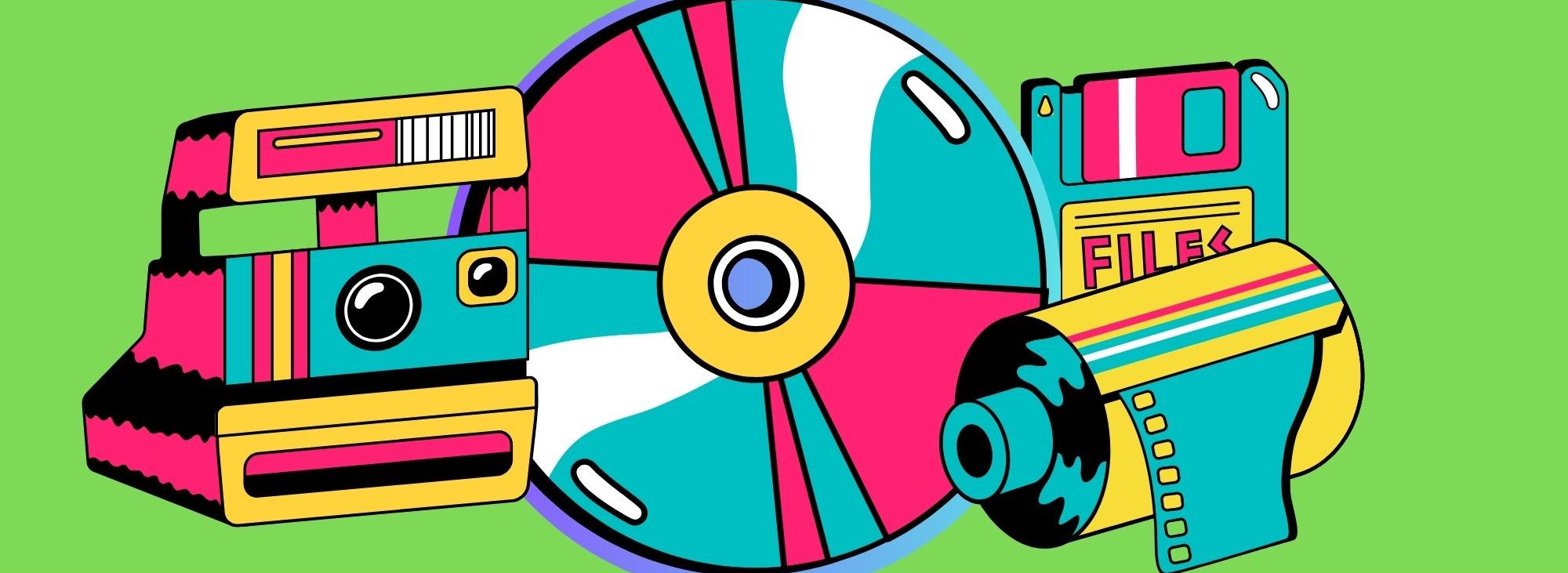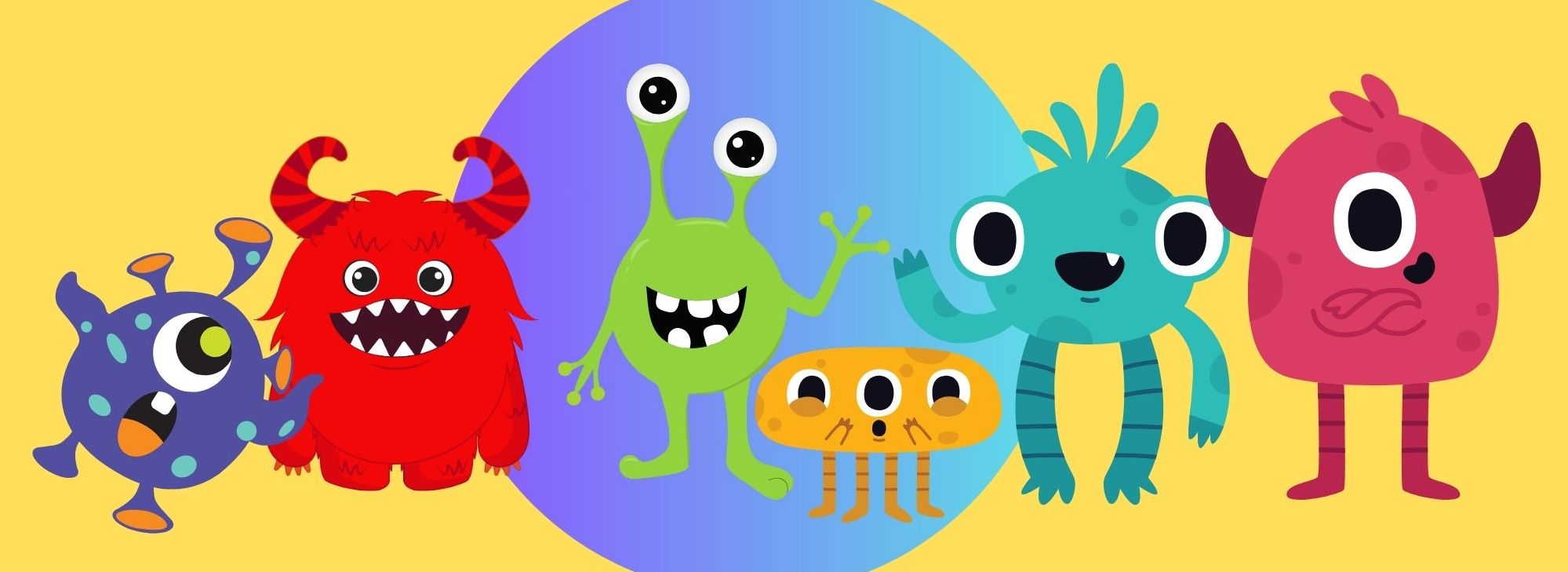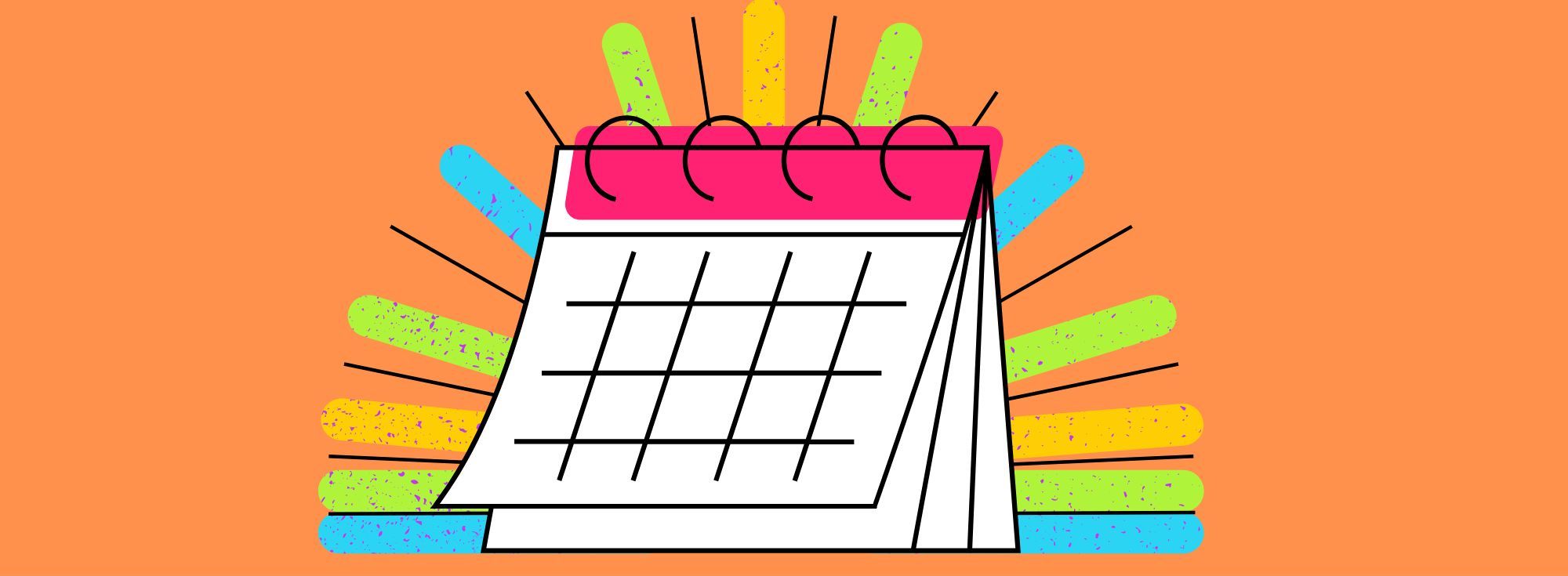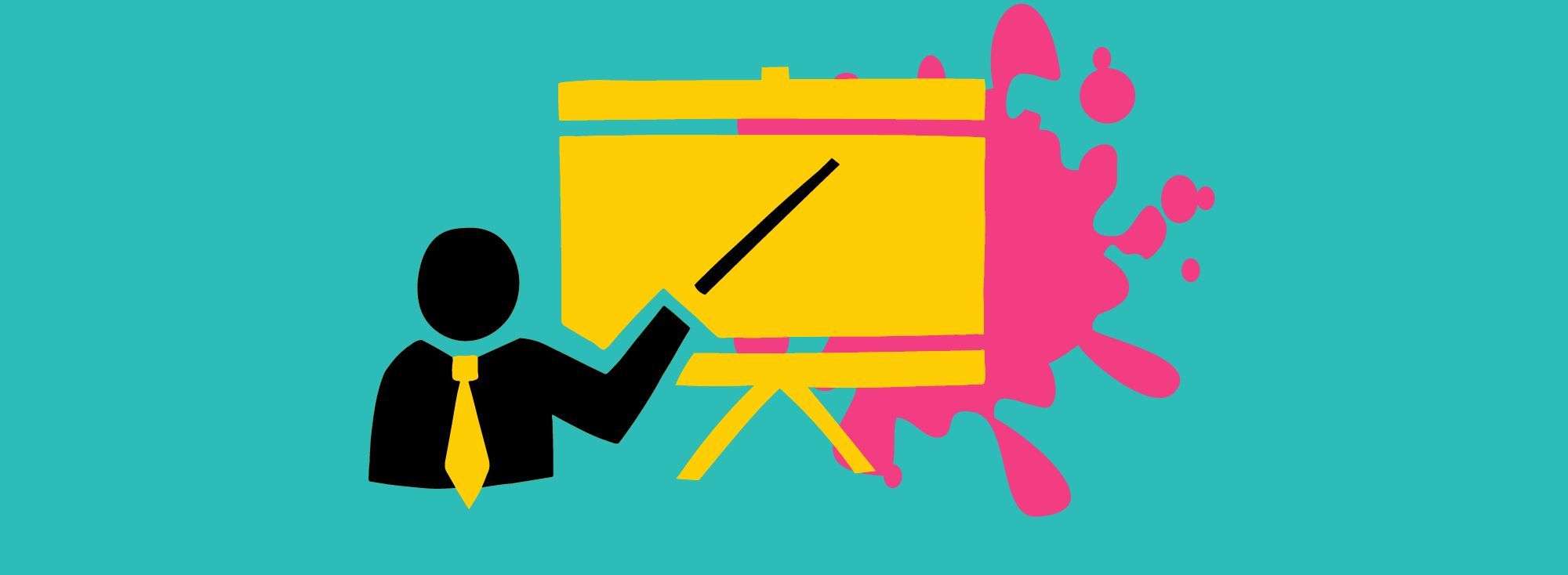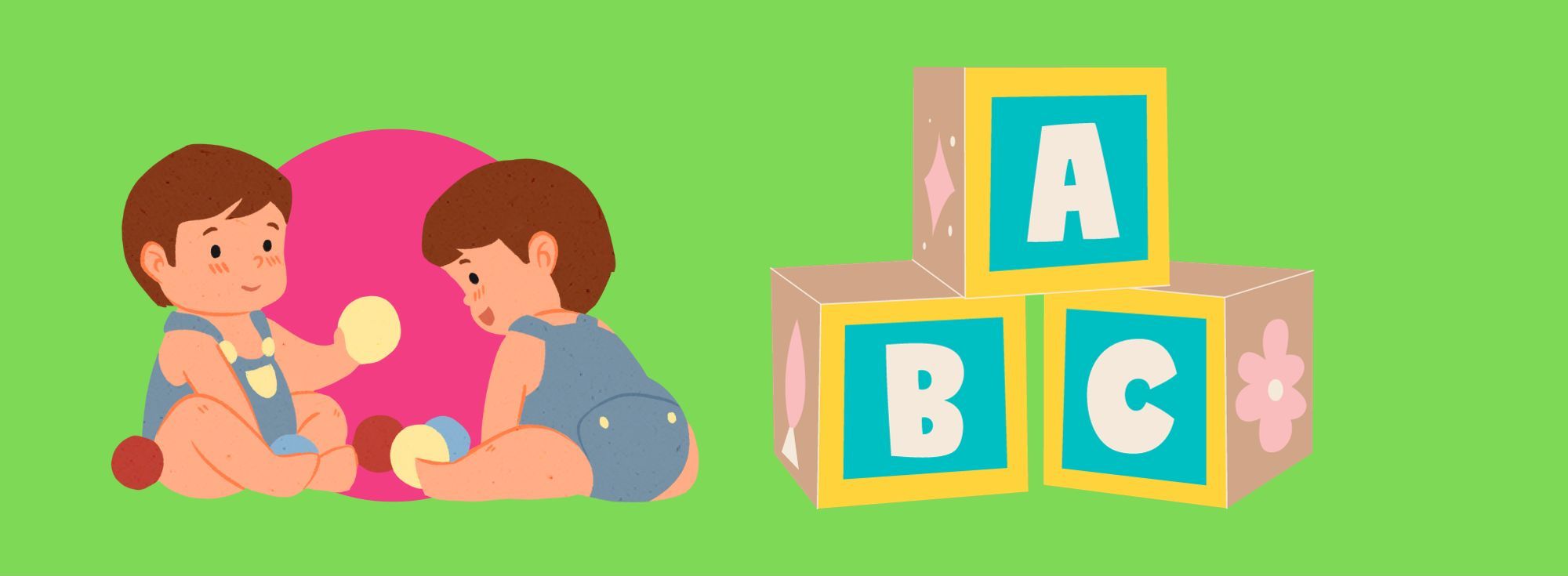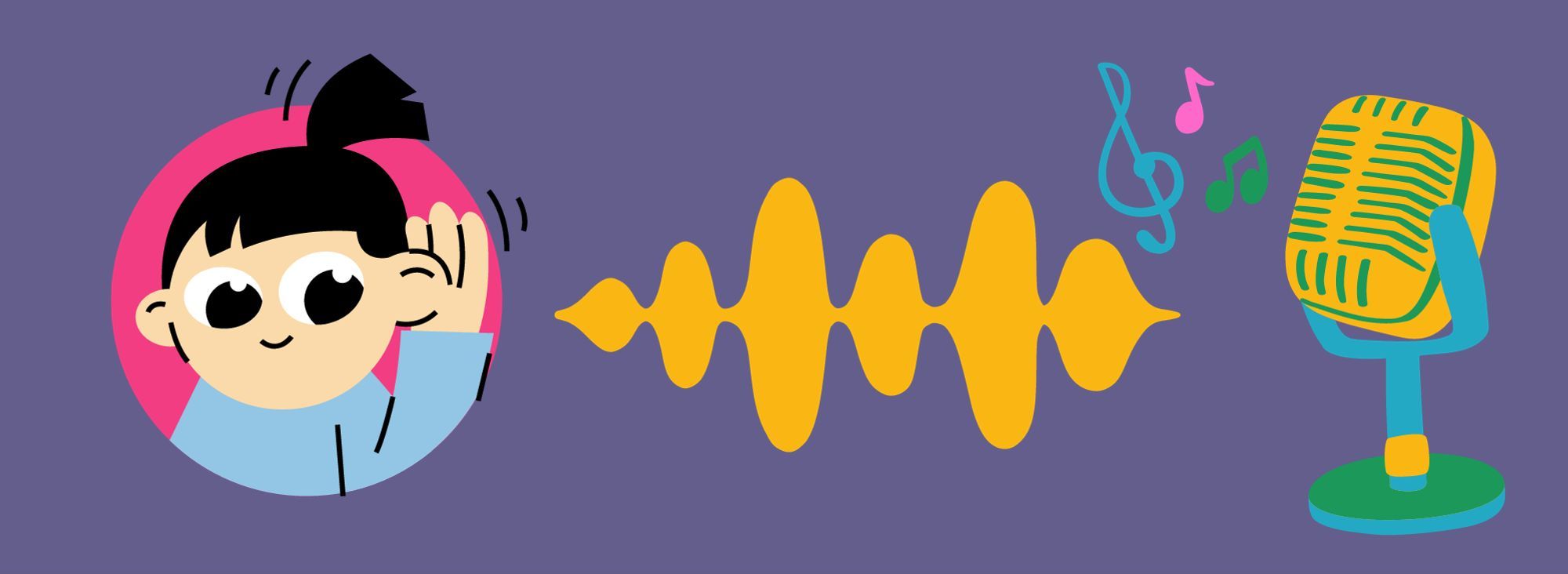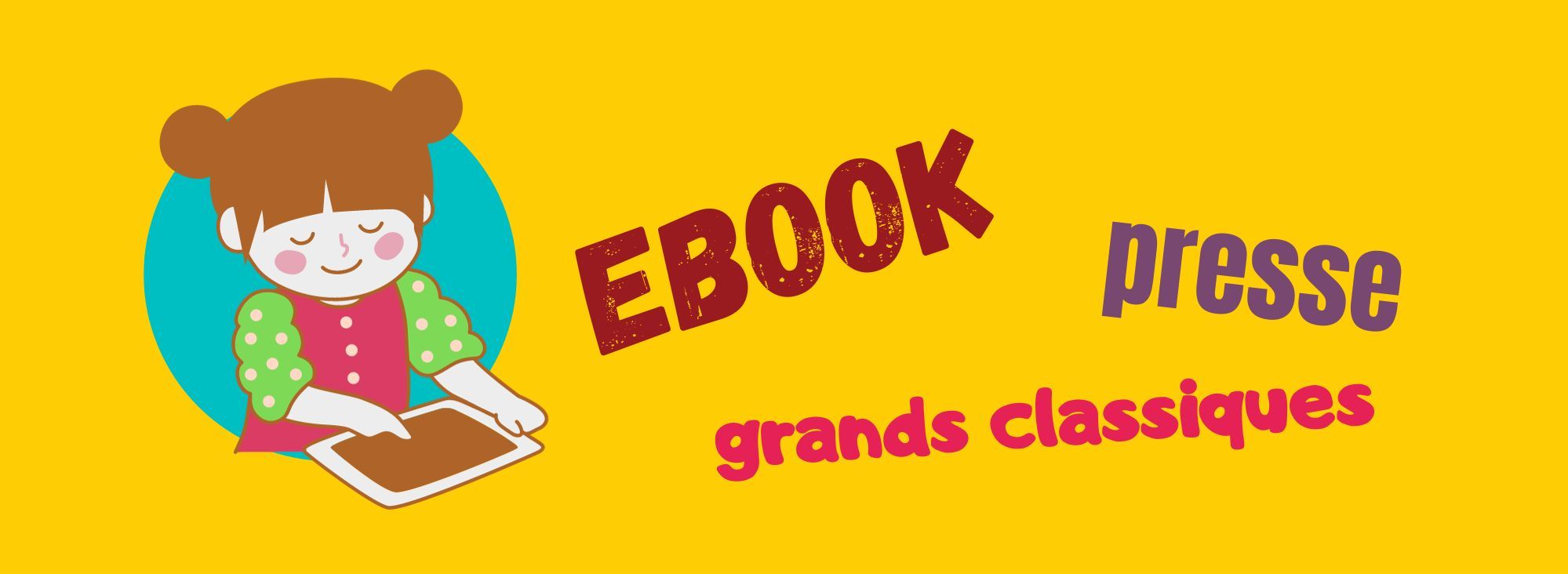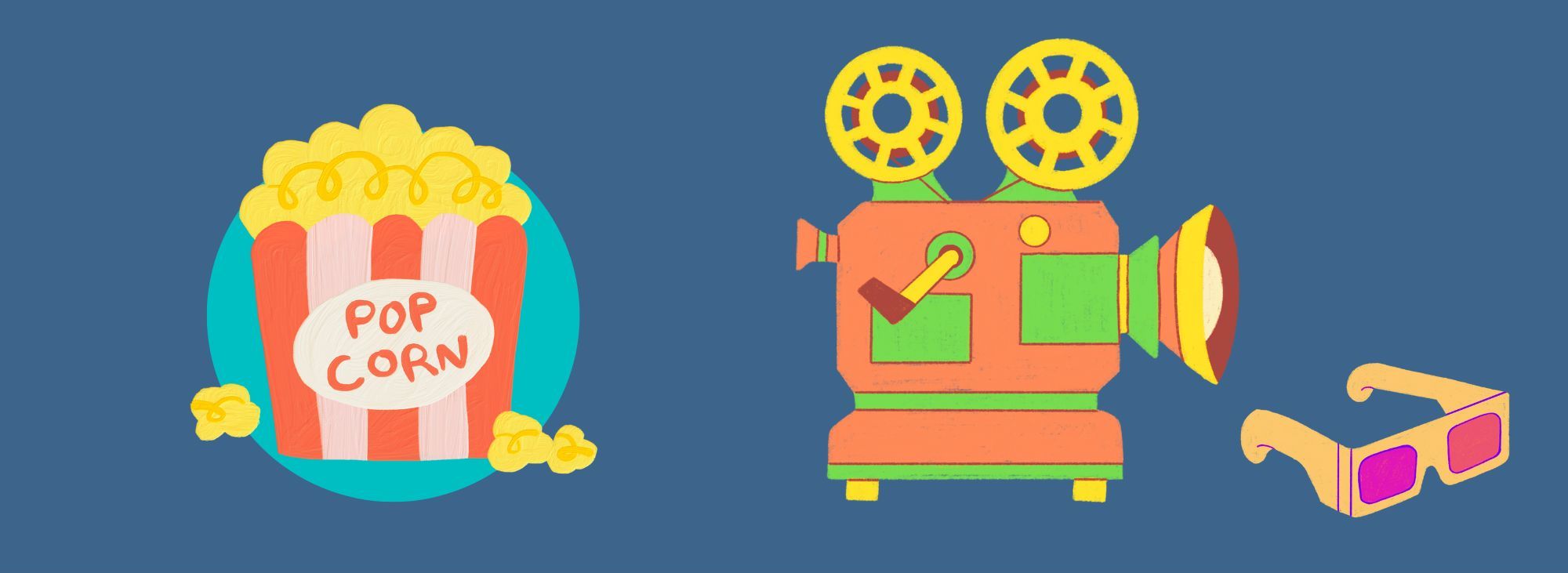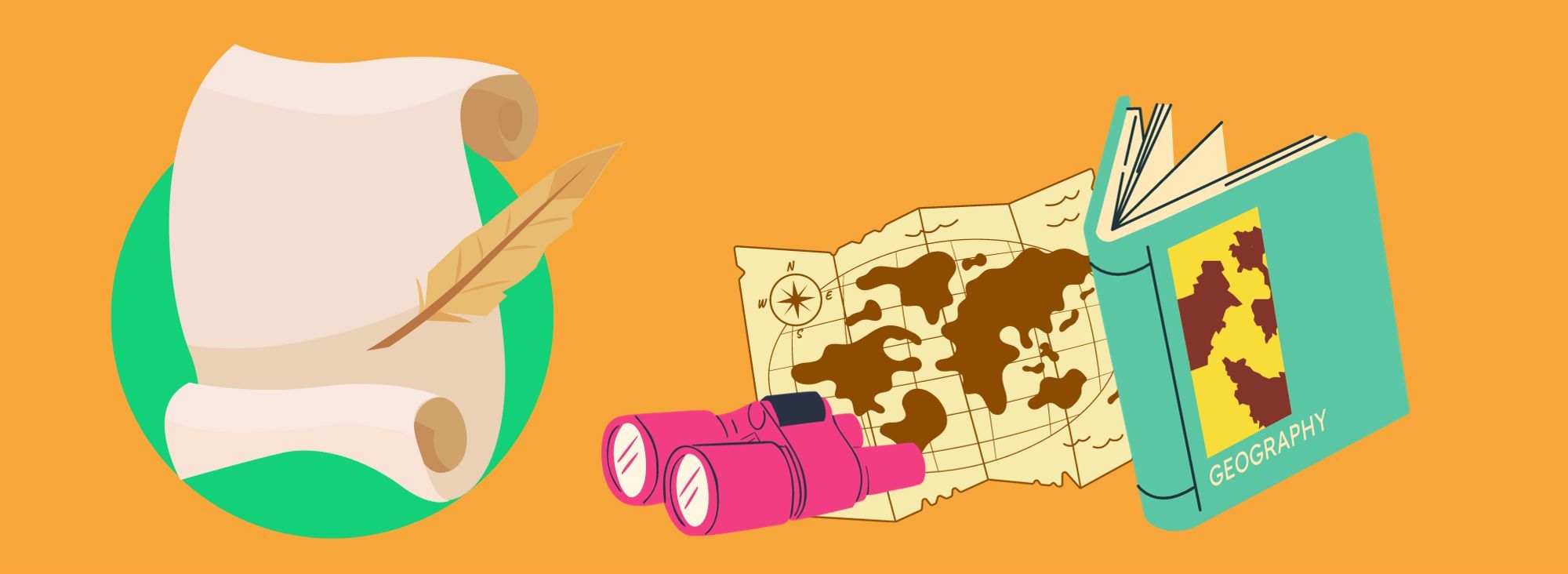1. Un patrimoine ancestral de transmission
Avant l’invention de l’imprimerie et la scolarisation de masse, les récits oraux étaient la principale forme d’éducation collective.
Les contes, légendes, proverbes et récits initiatiques permettaient aux adultes de transmettre :
- Des règles de vie (hospitalité, fidélité, prudence),
- Des codes de survie (éviter les chemins isolés, reconnaître les prédateurs sociaux),
- Des valeurs communautaires (honneur, solidarité, tabous à respecter),
- Et surtout, de prévenir des dangers :
- de la nature (forêt, mer, animaux),
- de la société (abus de pouvoir, mariages forcés, violence conjugale),
- de soi-même (désirs incontrôlés, orgueil, transgression des interdits).
2. Des récits parfois très sombres
Contrairement aux contes pour enfants édulcorés, les versions destinées aux adultes sont souvent crues, violentes, ambivalentes, car elles servent à dire ce qui ne peut pas se dire directement.
Exemples :
- Les contes d’ogres, de loups et de viols sont parfois des allégories du danger masculin pour les jeunes filles.
- Les pactes avec le diable ou les créatures surnaturelles alertent sur la tentation, la cupidité, l’orgueil.
- Les récits de vengeance ou de rédemption sont des outils de justice symbolique dans des sociétés sans tribunal accessible.
3. Oralité et communauté
Le conte oral pour adulte n'est jamais anodin : il est dit au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Il fait partie d’un pacte social :
- Il rassemble (au coin du feu, dans les veillées),
- Il répare (par l’humour ou la catharsis),
- Il met en garde sans accuser (par l’exemple symbolique).
4. Exemples de récits d’alerte
- Barbe Bleue : la curiosité féminine punie ? Ou une mise en garde contre les violences conjugales cachées ?
- La Femme squelette (conte inuit) : une métaphore du couple et de la peur de l’intimité.
- Le Joueur de flûte de Hamelin : le prix de l’ingratitude collective, ou une critique politique ?
- Les contes de la mort (Bretagne, Afrique, Haïti...) : pour apprivoiser l’idée de la finitude, et transmettre des rituels funéraires.
5. Aujourd’hui : un outil de prévention moderne
Dans les médiathèques, festivals ou prisons, le conte oral pour adultes revient en force :
- Pour parler de dépendances, de violences, de migration, de solitude.
- Par des conteurs contemporains comme Muriel Bloch, Catherine Zarcate, Abbi Patrix, Hassane Kouyaté, qui recréent un espace d’écoute collective et de parole taboue.
- Des initiatives associant conte et éducation populaire sont menées, par exemple, pour lutter contre les stéréotypes de genre ou les discriminations.
6. Le travail des Frères Grimm
Le travail des frères Grimm, Jacob (1785–1863) et Wilhelm (1786–1859), occupe une place essentielle dans l’histoire du conte populaire. Souvent perçus comme de simples collecteurs d’histoires pour enfants, ils sont en réalité les fondateurs d’un projet scientifique, culturel et linguistique majeur, avec des conséquences durables sur la littérature de jeunesse… mais aussi sur la vision du monde.
1. Qui étaient les frères Grimm ?
- Originaires d’Allemagne, linguistes, juristes et philologues.
- Passionnés par les traditions orales, ils s’inscrivent dans le mouvement romantique allemand qui cherche à préserver l’âme du peuple (« Volksgeist ») à travers ses récits.
- Leur but premier n’est ni moral, ni éducatif, mais scientifique et identitaire : sauvegarder la mémoire populaire germanique.
2. Le recueil Contes de l’enfance et du foyer (1812–1815)
- Premier titre : Kinder- und Hausmärchen (litt. « Contes d’enfants et du foyer ») — pas nécessairement pour les enfants !
- Il s’agit de transcriptions, souvent retravaillées, de récits oraux transmis par des paysans, nourrices, domestiques, femmes de la bourgeoisie.
- Les contes les plus célèbres :
- Blanche-Neige
- Hansel et Gretel
- Le Petit Chaperon rouge
- Cendrillon
- Raiponce
- Le Roi grenouille
- La Belle au bois dormant
3. Un travail d’adaptation, pas de simple collecte
- Les Grimm ont réécrit et normalisé les récits : ajout de formules d’ouverture (« Il était une fois »), d’éléments chrétiens (Dieu, la prière), suppression de certaines violences sexuelles.
- Le style évolue au fil des éditions : les premières versions sont plus crues, brutes, tandis que les suivantes s’adoucissent pour s’adresser davantage aux enfants.
- Cependant, la violence reste très présente : mutilations, cannibalisme, meurtres, punitions sanglantes…
Exemple :
Dans Cendrillon, chez les Grimm, les sœurs se coupent des morceaux de pied pour entrer dans la chaussure, et les colombes crèvent leurs yeux pour les punir de leur cruauté.
4. Une tension entre tradition et moralisation
- Les Grimm ne sont pas moralistes à l’origine, mais leur travail est récupéré à des fins éducatives dans l’Allemagne du XIXe siècle, puis dans toute l’Europe.
- On les accuse parfois d’avoir essentialisé les rôles féminins : mères absentes, marâtres cruelles, filles passives récompensées.
- Pourtant, leurs contes comportent aussi des figures féminines rusées, courageuses, ambivalentes.
5. Un impact mondial et durable
- Les contes des Grimm ont été traduits dans plus de 160 langues.
- Ils ont inspiré Disney, les manuels scolaires, les albums jeunesse, les psychanalystes (notamment Bruno Bettelheim), et la recherche folklorique.
- Aujourd’hui, ils sont régulièrement revisités et détournés pour lutter contre les stéréotypes ou réintroduire leur puissance symbolique originelle.
Voir aussi : les contes dévoyés
À télécharger :
 Comparatif des versions de contes : Grimm / Perrault / Disney
Comparatif des versions de contes : Grimm / Perrault / Disney
© Archives départementales de la Lozère 96 Fi 459 / Carte postale N/B 9x14 cm